Nous célébrons Halloween en évoquant certaines des erreurs les plus courantes qui peuvent transformer nos projets en « monstres ».
Projets européens : les « monstres » sont-ils parmi nous ?
Il est difficile de transformer une idée en un projet réussi et réalisable. C’est pourquoi nous partageons des outils et des conseils dans la section du guide consacrée à la planification, et nous avons récemment publié une série de vidéos d’orientation (vous pouvez les trouver dans le guide et sur YouTube).
Parfois, les problèmes viennent de l’extérieur : appels complexes avec de nombreuses exigences, peu de temps disponible, délais serrés. D’autres fois, ou en plus, les problèmes se situent au niveau de la conception : analyse superficielle du contexte, formulation trop générale des objectifs, planification temporelle ou financière inadéquate.
Une planification inefficace peut créer de véritables « monstres », et c’est de cela que nous voulons vous parler en ces jours d’Halloween. Outre des exemples, nous vous proposerons quelques mots-clés et conseils pour éviter les « monstruosités » et développer un projet ayant de bonnes chances d’obtenir un financement et d’atteindre ses objectifs.
Cet article est le deuxième de notre série sur les erreurs de conception (le premier, sur la capacité organisationnelle, se trouve ici). Nous poursuivrons cette série dans les mois à venir.
Le zombie : l’idée de design qui a resurgi du passé et qui n’est plus d’actualité
Mot-clé : actualité.
Commençons par une erreur courante : qui n’a jamais eu l’occasion, lors de la rédaction d’un projet, de ressortir du tiroir des idées du passé ? Des activités qui semblaient « mortes et enterrées » et qui, au contraire, sont ressuscitées et soumises à un nouvel appel ?
S’inspirer de projets antérieurs a ses bons côtés : cela permet de gagner du temps lors de la planification et de la rédaction du projet. Si vous le faites de manière stratégique, cela vous permet d’adapter les idées qui ont fonctionné à de nouveaux contextes ou d’améliorer celles qui n’ont pas fonctionné. Il est normal et utile d’avoir des idées dans un tiroir ou de les « geler » en attendant que le moment soit venu ou qu’un appel à propositions approprié soit lancé.
Mais attention à l’effet zombie : les besoins auxquels nous voulons répondre avec notre projet peuvent avoir changé depuis le passé et les activités peuvent ne plus être appropriées ; ou simplement, l’idée peut ne pas être adaptée au nouveau contexte. Dans ce chapitre, vous trouverez quelques conseils sur la manière de mener une analyse de contexte, telle que la cartographie des acteurs et l’analyse des besoins, tout en évitant l’effet « zombie ».
Si le projet que nous avons présenté avec ces idées et ces activités n’a pas obtenu de financement, demandons-nous pourquoi cela s’est produit. Relisons les évaluations que nous avons reçues de l’organisme de financement et réfléchissons à la validité de cette idée et de cette activité, ici et maintenant. Attention donc à l’effet « copier-coller » et au risque de répéter sans esprit critique les erreurs qui ont empêché notre projet précédent d’être financé ou de bien fonctionner.
N’oublions pas que, s’il n’est pas nécessaire d’inventer la roue à chaque fois, le design est aussi l’occasion de stimuler des solutions créatives : trop « pêcher » dans le passé pourrait avoir un effet limitatif sur la capacité d’innovation de notre organisation.
Notre conseil ? Ne pas « exhumer » mais « régénérer » : à partir du contexte, analysez le projet en éliminant les parties obsolètes et en conservant les éléments qui sont encore pertinents pour les besoins d’aujourd’hui, en intégrant les nouveaux éléments. De cette manière, l’héritage d’un projet passé sera mis en valeur et bénéficiera d’une nouvelle vie.
La réplique : la proposition de projet soumise indistinctement à plusieurs appels à propositions
Mot clé : authenticité.
Dans une approche proche de l’effet zombie, il arrive que les mêmes idées de projet soient utilisées indifféremment dans plusieurs appels à propositions, dans l’intention de maximiser (au moins théoriquement) ses chances d’obtenir un financement.
Cette méthode permet d’optimiser l’effort de conception, mais chaque appel à propositions européen est un monde à part : copier un projet (ou une partie de celui-ci) sans les adaptations nécessaires comporte le risque d’un manque d’adhésion aux exigences, thèmes et approches spécifiques de l’appel, réduisant drastiquement les chances d’obtenir une bonne évaluation et de voir son projet financé.
Dans certains cas, les appels incluent une clause dans les règlements qui disqualifie les projets qui ont déjà été soumis ou financés par d’autres programmes. Le recoupement est une pratique très répandue et le risque de voir son propre projet disqualifié existe.
Mais des risques existent également si notre projet est financé par plusieurs appels à propositions : s’il s’agit du même projet, il peut y avoir un risque de « double financement » (dont nous avons également parlé ici), c’est-à-dire de déclarer les mêmes coûts auprès de plusieurs sources de financement. Cette pratique peut entraîner la suppression du financement, des sanctions ou, dans les cas les plus graves, des poursuites judiciaires.
Tout cela peut nuire à la réputation de l’organisation auprès des organismes de financement, ce qui est bien plus grave que de ne pas voir un seul projet financé.I
NOTRE CONSEIL ? Adaptez, ne copiez pas : utilisez la proposition originale comme point de départ, mais adaptez le projet de manière à ce qu’il soit conforme aux objectifs, aux critères d’évaluation et à la langue spécifique de chaque appel.
Frankenstein : assemblage d’idées incohérentes ou d’éléments de projets antérieurs.
Mot clé : cohérence.
Une autre monstruosité typique de la conception est « l’effet Frankenstein », qui se produit lorsqu’un projet est créé en combinant des parties d’autres projets plus ou moins au hasard, en sacrifiant la cohérence interne et externe. Dans ce cas, les avantages l’emportent largement sur les risques car, s’il est vrai que l’on peut gagner du temps et inclure des activités déjà expérimentées, la validité du projet peut être sérieusement compromise par le manque de cohérence. Non seulement cela réduit considérablement les possibilités de financement, mais cela entraîne également de graves problèmes lors de la mise en œuvre, ce qui peut conduire à l’échec du projet.
Les différentes composantes (activités, méthodes, objectifs, résultats) sont développées au sein de projets avec un but, une finalité, une conception cohérente : les mélanger inconsidérément comporte un risque élevé qu’elles ne s’intègrent pas de manière cohérente et qu’elles entrent même en conflit les unes avec les autres. Nous pouvons gagner du temps dans la phase de conception, mais en réduisant la cohérence du projet, nous en diminuons considérablement la valeur. Et même si le projet est financé, nous risquons de gaspiller de l’énergie dans la phase de mise en œuvre, en essayant de forcer des éléments incompatibles à s’intégrer.
L’incohérence peut également se produire au niveau des objectifs, qui peuvent ne pas être clairs : le projet est un système dans lequel chaque élément contribue, à différents niveaux, à une vision et à une logique communes, qui servent à communiquer efficacement le projet vers l’extérieur.
Notre conseil ? Ne procédez pas « des parties au tout », mais « du tout aux parties » : définissez clairement la vision et les objectifs généraux du projet. Filtrez les parties d’autres projets en vous demandant si ces parties sont cohérentes avec la vision interne (objectifs et activités) et externe (résultats et vision) du projet. Vous pouvez vous aider d’outils tels que le cadre logique pour vérifier la chaîne de causalité entre ses composantes.
Le blob fish : un projet difficile à reproduire et à adapter à d’autres contextes
Mot-clé : adaptabilité.
Imaginons que nous ayons développé un projet parfaitement « taillé sur mesure » pour un appel à propositions. Notre projet a beaucoup plus de chances d’être financé et d’être efficace que d’autres propositions de projet qui peuvent manquer de spécificité.
Mais si l’objet du projet est trop étroit, il peut être très difficile de reproduire l’expérience et de l’adapter à d’autres contextes ou à des événements imprévus. Notre projet risque de connaître la triste fin du blobfish : un animal qui vit dans les profondeurs de la mer. Dans son milieu naturel, il est à l’aise et a une apparence tout à fait respectable, mais lorsqu’il est ramené à la surface, il change complètement en raison de la diminution de la pression de l’eau, prenant un aspect flasque et gélatineux.
Chaque projet, même s’il est unique, doit présenter un certain degré d’adaptabilité, de durabilité et de reproductibilité : à la fois pour l’organisation, qui souhaite développer ses activités grâce aux projets, et pour l’organisme de financement, qui souhaite utiliser ses ressources de manière efficace, en se concentrant sur des projets qui peuvent « perdurer » au-delà de la période de financement, et éventuellement s’adapter pour répondre à de nouveaux défis. Attention également au risque de « vieillissement prématuré » : un projet trop spécifique risque d’être moins apte à s’adapter aux changements de contexte au fil du temps.
Notre conseil ? Utilisez une approche modulaire : développez un projet dans lequel les éléments de base, en particulier les activités, sont conçus comme des modules autonomes, dont les éléments peuvent être standardisés et exportés vers d’autres contextes, en vous concentrant non seulement sur le contenu, mais aussi sur l’utilisation de méthodes reproductibles.
La momie : la structure de conception rigide avec peu de marge de manœuvre
Mot-clé : flexibilité.
Un projet est un ensemble de processus et d’activités qui dépendent de trois variables interconnectées (la « triple contrainte ») : la portée, le coût et le temps. Si l’on modifie l’une de ces variables, il est nécessaire d’adapter les autres en conséquence. Par exemple, une augmentation du nombre de groupes cibles, qui affecte le champ d’application, peut entraîner un allongement de la durée du projet et/ou nécessiter une augmentation des ressources. Par conséquent, dès la phase de planification, il est essentiel de maintenir une certaine flexibilité.
Un certain degré de précision est certainement utile : des estimations de coûts exactes et précises dans le budget permettent de mieux gérer le projet et augmentent la probabilité que les coûts pendant la mise en œuvre soient conformes à ce qui avait été prévu. De nombreux risques peuvent être évités grâce à une répartition claire des rôles, et une exécution linéaire des activités permet de rester concentré sur les objectifs et les résultats.
Mais si notre projet n’est pas élastique, il sera également plus difficile de l’adapter aux changements de contexte, aux nouveaux défis ou aux nouvelles opportunités qui se présentent. Trop de contrôle peut rendre le projet moins dynamique, limitant la capacité d’adaptation et d’apprentissage. Il est normal que certaines des solutions imaginées lors de la phase de conception ne se révèlent pas efficaces lors de la phase de mise en œuvre : si l’approche est uniquement axée sur l’exécution fidèle des activités, il y a un risque de continuer à exécuter quelque chose qui ne fonctionne pas, ce qui entrave la réalisation des objectifs et des résultats, ou l’émergence de meilleures solutions. Plus un problème critique est maintenu longtemps, plus les coûts et les difficultés à trouver une solution augmentent. La recherche de la perfection formelle, c’est-à-dire la volonté de réaliser un projet exactement comme prévu, peut conduire à ne pas répondre aux besoins pour lesquels le projet a été conçu. C’est la raison d’être des activités de suivi et d’évaluation: sortir de la rigidité et adopter les changements nécessaires pour assurer le succès substantiel du projet.
Notre conseil ? Imaginez le projet non pas comme une cage mais comme une armure : il doit être suffisamment rigide pour ne pas se disperser mais suffisamment souple pour résister aux chocs. Développez les activités non pas comme une chaîne ininterrompue, mais de manière à ce qu’elles soient organisées en phases distinctes et autonomes, avec leur propre budget et des délais définis, afin qu’un événement négatif dans une activité ait le moins de répercussions possibles sur les autres. Prévoyez une marge lors de la définition des délais et des coûts et, si possible, incluez dans le budget un montant à utiliser pour les imprévus.
Main : l’idée du projet qui coïncide avec une seule activité ou composante
Mot-clé : complexité.
Il peut arriver qu’une organisation se tourne vers les appels à propositions européens pour financer une activité spécifique, par exemple la réalisation d’un festival ou d’un atelier. Mais si nous ne voulons pas d’un projet qui ressemble à la « main » de la famille Addams, nous devrons résister à la tentation de nous concentrer exclusivement sur nos besoins immédiats et développer une proposition de projet plus large.
Un projet ne comportant qu’une seule activité ou composante peut présenter des avantages en termes de gestion et de clarté. Mais cette simplification s’accompagne presque toujours d’une capacité limitée à générer un impact à long terme, ce qui est l’objectif principal des organismes de financement. L’adaptabilité, dont nous avons parlé plus haut, est fortement menacée dans un projet qui coïncide avec une seule activité.
Dans un projet trop élémentaire, ou « unique », les possibilités d’apprentissage sont limitées et (paradoxalement) on peut être plus exposé à certains risques. En effet, bien qu’une complexité moindre entraîne moins de risques, dans un tel cadre, il peut suffire d’un seul risque (par exemple, l’annulation de l’événement) pour avoir un impact fatal sur le projet.
Les appels d’offres européens récompensent les projets qui ont une vision stratégique et qui sont capables de proposer des solutions à des problèmes complexes, ce qui n’est guère le cas des projets constitués d’une seule composante, voire d’une seule activité.
Le terme « complexité » dérive du verbe latin « embrasser, tenir ensemble » : dans le domaine de la conception, il s’agit de pouvoir composer un projet composé de plusieurs éléments fonctionnels qui se rejoignent dans un but commun. Et rappelons qu’un projet « complexe » ne signifie pas un projet « compliqué ».
Notre conseil ? Considérez l’activité individuelle comme la partie émergée d’un iceberg : l’activité centrale peut rester l’élément le plus visible du projet, mais elle doit être soutenue par d’autres activités ayant une vision plus large qui renforce son impact. Par exemple, ne proposez pas seulement l’événement, mais aussi la stratégie qui rend l’événement nécessaire pour répondre aux besoins identifiés, y compris, le cas échéant, les activités de recherche, l’analyse, la reproductibilité. Envisagez également la possibilité d’intégrer l’événement dans un projet à construire avec d’autres organisations partenaires( vous trouverezici et dans la pilule vidéo quelques idées pour créer des partenariats efficaces et ici un examen approfondi des accords de partenariat).
Du monstre au projet gagnant
Nous avons navigué à travers les cauchemars de la conception, en essayant de vous donner des pistes de réflexion sur certaines des approches qui peuvent limiter vos chances de créer des projets qui peuvent obtenir un financement et surtout créer une valeur durable. Un projet gagnant et percutant est toujours :
- actuelle, c’est-à-dire orientée vers les besoins et les défis actuels
- authentique, conçu sur la base des besoins identifiés et d’une réflexion sur l’appel
- cohérent, avec des éléments internes (objectifs, activités) contribuant à une vision commune
- adaptable, de sorte qu’il puisse être mis en œuvre avec une approche modulaire dans d’autres contextes
- flexible, suffisamment élastique pour résister aux chocs et intégrer les changements nécessaires
- complexe, c’est-à-dire conçu comme un système doté d’une vision stratégique et d’un impact à long terme
Le défi n’est pas facile à relever, mais le respect de ces critères permet d’éviter l’effet « monstre ».
Et vous, avez-vous déjà été confronté à l’un de ces « monstres » dans votre expérience de conception ? Lequel est le plus difficile à vaincre ?
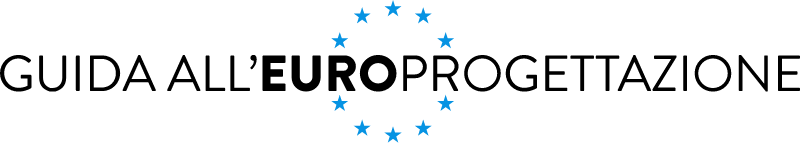



L’essentiel sur les projets européens : le Guide en 10 « bobines