Un examen approfondi des « aspects transversaux » du design européen : exemples et conseils sur la manière de les intégrer dans vos projets
Les aspects transversaux des projets européens : de quoi s’agit-il ?
Si nous considérons le design européen comme une pièce de théâtre, nous pouvons imaginer les projets comme les acteurs, le programme (ou l’appel) comme le scénario et les aspects transversaux comme la scénographie. Les aspects transversaux sont en fait le « cadre » de la conception mais, comme dans le cas d’une scénographie théâtrale, ils sont bien plus qu’un élément secondaire : il s’agit d’un ensemble de thèmes fondamentaux liés aux priorités politiques de l’UE qui interagissent avec tous les aspects du projet et visent à garantir que chaque action financée par des fonds européens contribue à des valeurs et à des défis communs.
Les aspects transversaux constituent donc la trame, la « toile de fond » de tout projet, mais ils en sont aussi un aspect substantiel. Ils doivent être intégrés à chaque étape, de la conception à l’évaluation du projet. Ils se distinguent des objectifs, qui se rapportent au domaine d’intervention spécifique et qui, pour reprendre la métaphore, représentent la « trame » de notre projet.
Il ne s’agit pas de simples « déclarations d’intention », mais de réponses à des exigences spécifiques figurant dans les programmes européens et les appels à propositions.
Les principaux aspects transversaux que l’on retrouve dans le design européen sont les suivants :
- Inclusion et diversité. Les projets doivent être accessibles et promouvoir la participation des personnes ayant moins d’opportunités, en luttant contre toute forme de discrimination en termes de sexe, de recensement, d’origine, d’orientation et de condition physique (pour n’en citer que quelques-unes) ;
- La durabilité environnementale et la transition verte. Les projets doivent pouvoir intégrer autant que possible des pratiques et des activités qui contribuent à réduire l’impact sur les écosystèmes et les ressources naturelles, à protéger l’environnement et à lutter contre le changement climatique ;
- Transition numérique et innovation. Les projets, quel que soit leur domaine d’intervention, doivent être l’occasion d’exploiter au mieux le potentiel des technologies numériques, d’améliorer les compétences numériques des participants et de promouvoir l’innovation numérique dans les méthodes et les résultats ;
- Participation civique et démocratique. Les projets doivent promouvoir la participation à la vie démocratique, une meilleure connaissance et sensibilisation aux valeurs fondatrices de l’UE et l’engagement social et politique des citoyens.
Les aspects transversaux des programmes européens
Ces aspects transversaux sont concrètement mis en œuvre de manière similaire dans les principaux programmes européens. Analysons-en quelques-uns.
Le programme Erasmus+ se réfère aux quatre priorités transversales déjà mentionnées : l’inclusion et la diversité, l’environnement et la lutte contre le changement climatique, la transformation numérique et la participation démocratique.
La page officielle consacrée à ces priorités présente des exemples de projets intéressants pour chacune des priorités sous la forme de courtes interviews vidéo. Le guide
Trois orientations stratégiques clés ont été définies dans le plan stratégique Horizon Europe 2025-2027:
- Transition verte, avec une section transversale du budget de 10 % allouée à la biodiversité (en plus du budget déjà spécifiquement affecté à l’action climatique) ;
- La transition numérique, avec 13 milliards d’euros consacrés aux technologies numériques clés entre 2021 et 2027 ;
- Une Europe plus résiliente, compétitive, inclusive et démocratique, une orientation qui inclut la recherche sur la sécurité civile, un modèle économique équitable et respectueux de l’environnement, la santé et le bien-être et la participation démocratique.
Les KSO sont spécialement conçus pour le deuxième pilier du programme, « Défis mondiaux et compétitivité industrielle européenne », et en synergie avec le pilier horizontal d’Horizon Europe « Élargissement de la participation et renforcement de l’espace européen de la recherche »(cliquez ici pour un aperçu de la structure et des piliers du programme).
Au sein des Fonds structurels, ce sont des dimensions très similaires qui occupent le devant de la scène, plutôt que des aspects transversaux. Le« règlement portant dispositions communes« , qui établit les règles unifiées pour la gestion des Fonds structurels, définit cinq objectifs stratégiques ou « objectifs politiques » pour l’ensemble de la programmation(programmes régionaux, programmes nationaux et coopération territoriale) :
- une Europe plus compétitive et plus intelligente,
- une Europe résiliente, plus verte et à faible émission de carbone,
- une Europe plus connectée, une
- une Europe plus sociale et plus inclusive et
- une Europe plus proche des citoyens.
Ces aspects sont donc à la fois transversaux et centraux dans l’orientation du financement. Ils sont normalement aussi mentionnés au niveau des appels à propositions individuels, avec des exigences supplémentaires en fonction du domaine d’action spécifique. Chacune de ces dimensions transversales s’inscrit dans le cadre des politiques européennes, qui (comme nous l’expliquons dans notre manuel) constituent la base des programmes, des appels et de l’attribution des projets.
Vous trouverez ci-dessous une brève analyse de chacune des principales dimensions transversales, avec une référence aux principales politiques européennes auxquelles elles se rapportent, ainsi que quelques indications sur la meilleure façon de les intégrer dans vos propres projets.
Inclusion et diversité
Il s’agit de l’égalité sociale, du principe de solidarité, de l’intégration des personnes handicapées, de l’égalité des sexes, du respect des minorités et de la diversité dans toutes ses manifestations.
Au cœur de l’inclusion se trouve l’acceptation des caractéristiques qui rendent chaque personne unique, tandis que la diversité décrit la variété inhérente à une société, qui se manifeste par la reconnaissance des distinctions entre les individus en raison de facteurs tels que l’âge, le sexe, l’appartenance ethnique, les croyances religieuses, le handicap, l’orientation sexuelle, le niveau d’éducation, la nationalité.
L’intégration de ce principe dans les projets est basée sur le concept » Leave No One Behind », c’est-à-dire veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte avant, pendant et après le projet en éliminant autant que possible les obstacles physiques, culturels, sociaux, économiques et géographiques à la participation.
Les documents politiques et stratégiques de l’UE qui sous-tendent ce principe sont les suivants :
- le traité sur l’Union européenne, en particulier l’article 2 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui met l’accent sur les valeurs de dignité, de liberté, d’égalité, de solidarité, de citoyenneté et de justice ;
- Le pilier européen des droits sociaux, qui comprend 20 principes pour un accès meilleur et plus équitable au marché du travail, des conditions de travail équitables, la protection sociale et l’inclusion.
À cela s’ajoute la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), approuvée en 1950 par les 46 États membres du Conseil de l’Europe, dont les 27 États membres de l’UE, pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Europe.
En ce qui concerne l’inclusion des personnes handicapées (un sujet que nous avons abordé dans un article récent), un document clé est la Stratégie pour les droits des personnes handicapées 2021-2030, basée sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (UNCRPD). Il est également important de prendre en compte la loi européenne sur l’accessibilité, qui entrera en vigueur en juin 2025.
En outre, il est utile de se référer aux priorités de la Commission européenne pour 2024-2029, en particulier la priorité« Soutenir les personnes et renforcer nos sociétés et notre modèle social » ainsi que les actions liées à la lutte contre la discrimination incluses dans l’action « Construire une Union de l’égalité ».
Pour obtenir des informations plus détaillées sur la législation, nous vous recommandons de visiter le site web EUR-Lex, point d’accès officiel à la législation de l’UE. Dans la section« Résumés de la législation de l’UE« , vous trouverez de brefs aperçus avec des liens vers des documents de référence organisés en 32 domaines thématiques. Dans le domaine de l’inclusion et de la diversité, nous vous recommandons les sections Droits de l’homme, Justice, liberté et sécurité et Emploi et politique sociale.
Pour des mises à jour sur les actions concrètes menées par la Commission européenne, une autre source de référence est le site web de la DG EMPL, la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, qui comprend une section consacrée aux politiques et aux activités dont la direction est responsable.
Voici quelques conseils pour un projet plus inclusif :
- Essayez d’assurer une représentation équitable des différences au sein de l’équipe de projet et des groupes cibles ;
- S’enquérir activement des besoins des bénéficiaires en fonction de leurs différences afin d’envisager le soutien le plus approprié ;
- Considérez non seulement les obstacles, mais aussi la contribution que les bénéficiaires, précisément en raison de leur diversité, peuvent apporter au projet.
Égalité entre les hommes et les femmes
Ce principe fait partie du principe plus large d’inclusion et de diversité mais, étant donné son poids croissant dans la conception européenne, nous lui consacrons une étude plus approfondie.
L’égalité entre les femmes et les hommes signifie « l’égalité des droits, des responsabilités et des chances pour les femmes et les hommes, les filles et les garçons » (EIGE). L’égalité entre les femmes et les hommes implique et engage pleinement les hommes et les femmes, afin de garantir l’égalité d’accès dans six domaines clés définis par l’index de l’égalité entre les femmes et les hommes: le travail, l’argent, le savoir, le temps, le pouvoir et la santé.
En ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, les principales références au niveau de l’UE sont les suivantes :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne(article 23);
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE, articles 8 et 157) ;
La stratégie de l’UE « Une Union de l’égalité : la stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2020-2025« , qui définit cinq domaines d’action prioritaires.
Nous soulignons également la feuille de route pour renforcer les droits des femmes, élaborée dans le cadre des Priorités 2024-2029 de la Commission européenne, qui comprend des liens vers d’autres documents et sources, tels que le rapport annuel sur l’égalité entre les femmes et les hommes en Europe (disponible pour 2025).
Dans les appels d’offres européens, cela se traduit par des exigences telles que la soumission d’un plan d’égalité entre les femmes et les hommes (PEG), parmi les exigences obligatoires d’Horizon Europe, et l’encouragement de l’intégration de la dimension de genre. Le PEG est un plan stratégique et organisé visant à promouvoir et à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’environnement de travail des entreprises et des organismes publics. L’intégration de la dimension de genre dans les projets, quant à elle, signifie la prise en compte systématique des différences entre les femmes et les hommes dans toutes les phases du projet.
L’objectif ultime est de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et de lutter contre les discriminations, en veillant à ce que chacun bénéficie de manière égale des mesures prises et que les inégalités ne se perpétuent pas.
Trois conseils pour un projet plus équitable du point de vue du genre :
- essayez d’assurer un équilibre entre les hommes et les femmes au sein de l’équipe du projet et aux différents niveaux de prise de décision ;
- Inclure la perspective de genre dans l’analyse du contexte et des besoins au stade de la conception ;
- inclure des données ventilées par sexe et des indicateurs spécifiques pour le suivi et l’évaluation des projets.
Transition numérique et innovation
La transition numérique est une stratégie visant à développer une transformation numérique au bénéfice de tous, avec une approche qui place l’individu et les valeurs européennes au centre. Dans les intentions de l’UE, la transition numérique doit pouvoir mettre la technologie au service des personnes, conduire à un développement équitable et compétitif de l’économie numérique, créer des espaces numériques sûrs, accessibles et inclusifs, soutenir des actions pour une plus grande durabilité environnementale.
Les politiques européennes et les documents de référence officiels sont
- la boussole numérique 2030, qui définit des objectifs stratégiques pour la décennie numérique ;
- la déclaration européenne sur les droits numériques et les principes pour la décennie numérique, qui promeut une transition numérique plaçant la personne au centre et fondée sur les valeurs de l’UE (nous en avons parlé ici) ;
- Au niveau législatif, nous souhaitons souligner, pour ses aspects novateurs, le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act), la première loi au monde à établir des normes harmonisées sur l’IA, basées sur une approche axée sur le risque (risque inacceptable, élevé, limité, minimal).
Sur le site EUR-Lex, il est possible d’accéder, via la sous-section « Politique de recherche et d’innovation« , à une série de liens vers des documents de référence, dont le programme « Digital Europe 2021-2027« .
Du point de vue de l’action politique, le numérique et l’innovation constituent l’une des dimensions les plus transversales, mais pour ce qui est des perspectives spécifiques, les organes les plus impliqués sont la DG Connect et l’agence exécutive HADEA. Une vue d’ensemble des politiques dans le domaine de la société numérique, des technologies numériques avancées (y compris l’intelligence artificielle), de la coopération internationale dans le domaine numérique et de l’économie numérique est disponible sur le site web de la DG Connect.
Trois conseils pour un projet contribuant à la transition numérique :
- au stade de la conception, essayez d’inclure l’aspect numérique des activités dès le début, plutôt que d’intégrer des composants numériques à un stade ultérieur pour répondre aux exigences de l’appel ;
- inclure des indicateurs de suivi couvrant la composante numérique tant du point de vue de l’activité que de la gestion du projet ;
- la mesure numérique intégrée de la durabilité en tentant de quantifier la diminution de l’impact environnemental d’un projet grâce à l’adoption de solutions numériques (par exemple, la réduction de l’énergie et des émissions), démontrant ainsi que la transition numérique est un catalyseur de la transition verte.
Durabilité environnementale et transition verte
La durabilité environnementale est le principe qui garantit l’équilibre écologique à long terme, en répondant aux besoins actuels sans compromettre les générations futures. Elle s’incarne dans six objectifs clés : l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets, l’utilisation durable des ressources, l’économie circulaire, la lutte contre la pollution et la protection de la biodiversité. La transition verte est la stratégie politique de l’UE qui définit la feuille de route pour mettre en œuvre ce changement, un processus qui implique une transformation profonde et généralisée aux niveaux économique, politique, social et culturel.
Les politiques européennes pertinentes sont les suivantes :
- le Green Deal européen et la communication de la Commission européenne à ce sujet ;
- La loi européenne sur le climat, qui consacre l’objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, accompagnée du paquet législatif « Fit for55 » pour sa mise en œuvre ;
- Le règlement de l’UE sur la taxonomie est un document plus technique, mais qui fournit la définition la plus opérationnelle de ce qui constitue une activité économique durable du point de vue de l’environnement.
L’importance de ce principe est également reflétée dans le nouveau cadre financier pluriannuel 2028-2034 (la nouvelle proposition de budget de la Commission européenne, que nous avons examinée ici), qui envisage de consacrer au moins 35 % des ressources à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du Green Deal.
Dans le cadre des priorités 2024-2029 de la Commission européenne, la page consacrée à la priorité« Préserver la qualité de vie : sécurité alimentaire, eau et nature » contient des informations utiles ainsi qu’un calendrier des progrès réalisés en matière de politiques, d’actions législatives et d’initiatives. En outre, un résumé de la législation européenne en matière d’environnement et de changement climatique est disponible sur le site web EUR-Lex, avec des liens vers des documents de référence.
En outre, il existe un certain nombre de documents stratégiques plus spécifiques, tels que la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et le règlement relatif à la restauration de la nature, ou, dans le secteur agroalimentaire, la stratégie « de la ferme à la table » (dont nous avons parlé récemment dans cet article du podcast « Food for Europe »).
Les aspects liés au climat et à la durabilité environnementale sont traités en particulier par la direction générale de l’action pour le climat, la DG CLIMA, en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, avec des éléments partagés avec d’autres directions telles que la DG AGRI, responsable du secteur agricole, et la DG ENER, responsable du secteur de l’énergie. Une sélection de liens vers des politiques, des initiatives et des aperçus thématiques est disponible sur les pages d’accueil des sites web des directions.
Les appels d’offres comportent de nombreuses exigences en matière de durabilité environnementale, parfois très conditionnelles, telles que l’écoconditionnalité renforcée, un système de règles obligatoires qui exige le respect des critères de gestion obligatoires (CGO) et les règles de maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) pour les agriculteurs bénéficiant de fonds de la politique agricole commune (nous consacrons beaucoup d’espace dans le guide à la PAC et aux fonds ruraux).
Trois conseils pour un projet européen contribuant à la transition verte et à la durabilité environnementale :
- inclure des actions, même petites, qui contribuent à réduire l’empreinte écologique de votre projet, par exemple en utilisant des moyens de transport ayant moins d’impact sur l’environnement, en établissant des normes anti-gaspillage, en réduisant le plastique, etc ;
- envisagez d’inclure des indicateurs de suivi spécifiques pour mesurer le niveau de durabilité environnementale du projet ;
- développe des actions visant à promouvoir des comportements vertueux également de la part des bénéficiaires des projets, par exemple en prévoyant un budget adéquat pour des voyages à faible empreinte CO2.
Participation civique et démocratique
Le mot clé de cet aspect transversal est la participation, entendue comme la possibilité pour les personnes de s’exprimer et de contribuer aux décisions qui ont un impact sur leur vie. Ce principe concerne la possibilité de prendre part à la vie démocratique à tous les niveaux, local, national et européen, par le biais d’opportunités significatives dans lesquelles les participants peuvent exprimer leurs opinions, contribuant ainsi à développer un plus grand sentiment d’appartenance à la communauté européenne. En tant qu’aspect transversal, elle concerne également la capacité d’un projet à promouvoir la pensée critique, l’éducation aux médias, les compétences civiques et interculturelles, et la compréhension des valeurs communes de l’UE. Dans ce cadre, la participation des jeunes est un aspect clé, un sujet que nous avons également abordé avec notre partenaire technique Europiamo dans cet article.
Les principales références d’un point de vue législatif et politique européen sont les suivantes :
- Le traité sur l’Union européenne, en particulier les articles du titre II – Dispositions relatives aux principes démocratiques (articles 10, 11 et 12) ;
- La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le titre V consacré à la citoyenneté, énonce les droits civils et politiques essentiels à la participation ;
- Recommandation (UE) 2023/2836 relative à la promotion de l’implication et de la participation effective des citoyens et des organisations de la société civile dans les processus d’élaboration des politiques publiques ;
- La stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse 2019-2027 est consacrée à l’implication des jeunes.
Ce sujet est au cœur de l’agenda stratégique de la Commission européenne, l’une des priorités pour 2024-2029 portant sur la protection de la démocratie et des valeurs européennes. Sur la page dédiée à cette priorité, il est possible non seulement d’accéder à une vue d’ensemble des différents domaines dans lesquels cette priorité est déclinée (de la liberté de la presse à l’éducation aux médias en passant par des mesures telles que la conditionnalité renforcée), mais aussi d’accéder à des éclairages utiles tels que le rapport 2025 sur l’État de droit dans l’Union européenne.
Enfin, sur le site EUR-Lex, dans la section Justice, Liberté et Sécurité, il est possible d’accéder à un aperçu des liens vers les documents de référence, en particulier dans la sous-section « Citoyenneté de l’Union ».
Trois conseils pour un projet européen qui contribue à la participation civique et démocratique :
- Envisagez la possibilité pour les bénéficiaires du projet de contribuer directement aux activités, par exemple par le biais de la co-conception ou d’actions de suivi civique (nous en avons discuté ici) ;
- Lorsque vous communiquez sur le projet, incluez, si possible, des activités de restitution aux citoyens, des événements de débat public et du matériel de diffusion accessible ;
- Veillez à ce que le projet soit structuré de manière à fournir les informations nécessaires et un espace sûr pour que les bénéficiaires puissent partager et exprimer leurs points de vue.
Les aspects transversaux : la véritable clé de l’impact ?
Nous avons vu ce que sont les aspects transversaux, d’où ils proviennent en termes de valeurs et de politiques européennes, comment ils peuvent être intégrés dans des projets et comment ils se traduisent en priorités et exigences spécifiques dans les programmes européens.
Les aspects transversaux ne sont pas de simples exigences bureaucratiques, mais de véritables catalyseurs d’impact: s’ils sont correctement intégrés, ils augmentent non seulement les chances de financement, mais aussi le potentiel de transformation du projet individuel, en renforçant l’alignement entre les politiques, la programmation et les projets européens.
Nous reviendrons sur les éléments de cette « scénographie » dans les mois à venir, avec des idées, des outils et des expériences sur les différents aspects transversaux.
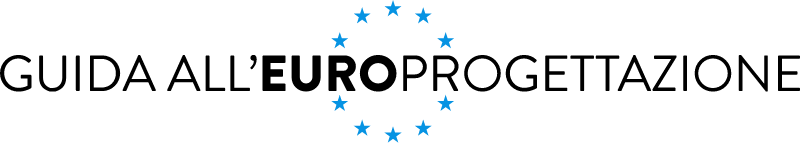



Lost in Translation : les langues dans le design européen