Appels descendants et ascendants : apprenez à mieux les connaître pour pouvoir choisir l’appel le plus adapté à notre idée de projet.
De la « liste de courses » au projet : approche descendante et ascendante dans les appels d’offres européens
La réussite d’un projet commence par le choix de l’appel à propositions. Le point de départ est certainement de se tenir au courant des opportunités de financement en suivant les mises à jour sur les sites web des différents programmes de l’UE et d’autres portails dédiés, comme notre portail d’appels à propositions, qui est mis à jour mensuellement.
Mais savoir quels appels sont disponibles n’est qu’une première étape : l’étape suivante consiste à comprendre, parmi les nombreuses possibilités, celles qui correspondent le mieux à notre idée de projet. Dans cet article, nous examinerons les approches descendante et ascendante des appels à propositions européens, la manière dont elles déterminent le degré de flexibilité d’ un appel, ainsi que les stratégies de développement de projets conformes à chacune des deux approches.
Si l’on compare un appel à l’action à une« liste de courses« , c’est comme si l’on nous demandait d’acheter « du lait, du pain et des œufs », avec la liberté de choisir la marque de lait ou le type de pain spécifique ou, pourquoi pas, de remplacer le pain par des biscuits, tant que l’objectif du « petit-déjeuner » est atteint ; ou si l’on nous demandait d’acheter un litre de lait d’une marque spécifique, deux cents grammes de pain de seigle et six œufs biologiques. Dans un cas (indications générales), nous sommes dans une approche bottom-up, c’est-à-dire ascendante ; dans l’autre (liste plus détaillée), nous sommes dans un mode top-down, c’est-à-dire descendant.
Il n’y a pas de méthode meilleure que l’autre, car chaque liste de courses, tout comme les approches descendante et ascendante, répond à des besoins et à des méthodes différents : dans un cas, dans la liste détaillée, on commence par la vue d’ensemble, par exemple le menu de la semaine, et on définit ensuite les ingrédients individuels en amont, tandis que dans l’autre, l’objectif principal, le petit-déjeuner, est principalement pris en compte, ce qui laisse plus de choix et la possibilité de substituer un aliment par un autre similaire.
Si nous considérons la personne qui a rédigé la liste de courses comme l’organisme de financement et la personne qui fait les courses comme l’organisation ou l’organisme qui présente un projet, nous pouvons facilement deviner les conséquences, les limites et les aspects positifs de l’adoption d’une approche plutôt que d’une autre.
Avant d’aborder chacune des deux approches, il est important de rappeler que si les politiques, programmes et appels à propositions européens font souvent référence à l’approche descendante et à l’approche ascendante, il n’existe pas de définition officielle communément adoptée. En effet, selon le programme et le domaine d’action (recherche, développement local, éducation, etc.), différents aspects et nuances sont mis en avant.
C’est le cas, par exemple, de la définition des deux approches dans le guide Horizon Europe de l’APRE, où les caractéristiques top-down et bottom-up sont déclinées en fonction des spécificités du secteur de la recherche et de l’innovation. L’approche ascendante est également appelée « curiosity-driven », se référant principalement à la recherche fondamentale et exploratoire.
Dans le cadre des Fonds structurels(FSE+ et FEDER), l’approche ascendante est définie (plutôt qu’en termes d’innovation) en termes de « développement local participatif ». Défini dans le règlement (UE) 2021/1060 (articles 28 et 31-34), il s’agit d’une méthode de planification, de programmation et de mise en œuvre dans laquelle les priorités, les objectifs et les actions à financer sont identifiés, proposés et définis de manière substantielle par les acteurs locaux et régionaux (administrations, partenaires économiques et sociaux, société civile).
En gardant cette prémisse importante à l’esprit, nous allons donc approfondir chacune des deux approches, en fournissant une définition de départ, en identifiant les aspects positifs et les aspects plus difficiles, en donnant quelques conseils et en présentant des exemples d’appels européens à titre de référence.
L’approche descendante
Comme nous l’avons vu, l’approche descendante commence par une vue d’ensemble, « le menu », et se poursuit de haut en bas avec un niveau de détail croissant. Cela signifie que dans un tel appel, les éléments suivants sont identifiés :
- les objectifs (généraux et spécifiques) et le problème que les projets soumis devraient contribuer à résoudre ;
- une liste de thèmes, de sujets, de priorités et de publics cibles pour l’intervention ;
- une liste de résultats attendus contraignants (produits et résultats), dans certains cas avec des indicateurs de performance et d’impact déjà décrits dans l’appel ;
- une liste plus ou moins détaillée d’actions éligibles, parfois associée à des contraintes supplémentaires (par exemple, un budget maximum par type d’activité).
Aspects positifs et limites de l’approche descendante
L’approche descendante est présente dans la plupart des appels d’offres européens. Elle présente un certain nombre d’avantages :
- Il favorise la cohérence entre les projets financés et les stratégies de l’UE. Les questions et les problèmes que le projet doit contribuer à résoudre sont clairement définis, ce qui garantit l’alignement ;
- Elle permet un meilleur contrôle des résultats attendus, grâce à la présence d’indicateurs de suivi spécifiques (KPI). C’est également pour cette raison qu’il s’agit d’une approche utile pour gérer efficacement des projets complexes et de grande envergure, dans lesquels de nombreuses actions et de nombreux acteurs différents sont présents ;
- Il définit clairement ce que l’on attend des projets et quelles sont les exigences, de sorte que les organisations proposantes puissent comprendre dès le départ quelles sont les attentes exactes de l’organisme de financement.
Cette approche présente également des limites :
- Un manque de flexibilité, qui peut limiter le degré d’innovation des propositions de projets ;
- Il y a un risque de perdre le contact avec la dimension locale et les défis des territoires individuels ;
- Le risque qu’une vision donnée des problèmes et des solutions se révèle partiellement ou totalement inexacte, produisant de mauvais résultats ou des externalités négatives.
Approche d’un appel d’offres descendant
L’approche d’un appel descendant implique une analyse minutieuse de l’adhésion de l’idée du projet aux exigences de l’appel. Les questions suivantes doivent être posées :
- Les objectifs de mon idée sont-ils conformes ou s’écartent-ils (et dans quelle mesure) des objectifs de l’appel ?
- Le domaine thématique de ma proposition correspond-il à ce qui est défini dans l’appel à propositions ?
- Mon projet contribue-t-il de manière directe et mesurable aux résultats attendus spécifiés dans l’appel à propositions ? Mon projet pourra-t-il garantir ces résultats ?
- Mon idée de projet correspond-elle au type d’actions requises ?
Un projet se prête particulièrement bien à un appel descendant si
- L’idée a été conçue indépendamment de l’appel à propositions, mais ses objectifs, son secteur et les résultats qu’elle vise correspondent à ce qu’exige l’appel à propositions. Dans ce cas, le travail d’adaptation du projet à l’appel ne conduira pas à dénaturer l’idée du projet ;
- L’idée est spécifique et prend la forme des types d’actions requises par l’appel ;
- L’organisation proposante est en mesure d’élaborer une proposition qui répond à toutes les exigences et contraintes, y compris formelles (telles que le nombre de partenaires à impliquer, le niveau de cofinancement, etc.
L’approche ascendante
Dans l’approche ascendante, en revanche, l’objectif global de l’appel est très clair, tandis qu’une plus grande marge de manœuvre est laissée pour définir la manière dont l’objectif doit être atteint. Cela signifie qu’un tel appel :
- fournit un cadre global de priorités stratégiques et d’objectifs généraux, mais laisse plus de liberté et d’autonomie dans la définition du problème à résoudre et des objectifs spécifiques du projet ;
- a un champ d’application moins circonscrit : il peut prévoir des macro-domaines thématiques, mais sans indiquer de sous-thèmes ou de sujets spécifiques. Dans certains cas, il ne prévoit aucune contrainte thématique. Le groupe cible est défini de manière plus large, avec moins de restrictions ;
- ne comprend pas de liste de résultats attendus contraignants, qu’il appartient au proposant de décrire de manière crédible et mesurable, en illustrant leur impact spécifique et les indicateurs proposés ;
- accorde une grande flexibilité dans la définition des activités et des ressources, limitée uniquement par la cohérence avec l’objectif proposé, avec peu de contraintes en termes de budget et de coûts éligibles.
Aspects positifs et limites de l’approche ascendante
L’approche ascendante est moins présente dans les appels à propositions européens, mais elle est utilisée dans certains domaines, tels que l’innovation fondamentale, la recherche exploratoire et la participation citoyenne, où elle présente des avantages importants :
- La possibilité de recueillir des idées et des solutions transformatrices et de débloquer l’innovation spontanée (aspects qui ne peuvent être planifiés « d’en haut ») ;
- La plus grande possibilité d’adhésion et de pertinence aux besoins locaux ou à des secteurs plus spécifiques ;
- La possibilité de valoriser l’excellence en finançant des projets présentant le plus haut degré de créativité, indépendamment des contraintes liées au sujet ou à l’approche ;
- Le plus grand degré d’inclusivité, avec la possibilité de financer des organisations, telles que les petites et moyennes entreprises, qui ont souvent plus de difficultés à accéder aux appels d’offres descendants.
Même l’approche ascendante présente des limites et des défis :
- Le risque d’un alignement stratégique et d’une cohérence des projets avec les politiques européennes plus difficiles ;
- La difficulté de mesurer l’impact global d’un appel, qui peut être plus dispersé à travers différentes initiatives et domaines thématiques, avec des indicateurs non uniformes pour mesurer l’impact ;
- La plus grande complexité de l’évaluation des idées de projet, qui peuvent être très différentes ;
- un effort plus important pour définir le problème, les objectifs spécifiques et les indicateurs de résultats, éléments qui, dans les appels descendants, sont en grande partie déjà esquissés ;
- Il existe un risque de concurrence très élevée, précisément en raison de la plus grande accessibilité des appels dont les thèmes sont moins circonscrits.
Approche d’un appel d’offres ascendant
L’approche d’un appel ascendant peut sembler plus simple dans un premier temps. La moindre présence de contraintes est en effet compensée par l’importance accordée à l’innovation et surtout à la démonstration en temps utile de la manière dont le projet peut réellement contribuer à résoudre le « problème » posé par l’appel. Les questions suivantes doivent être posées :
- Quel est exactement le problème que nous voulons résoudre ?
- Pourquoi personne d’autre n’a-t-il pu résoudre le problème jusqu’à présent ?
- Quel est l’élément innovant (ou même novateur) de mon idée par rapport à l’état actuel de la technique ?
- Quels sont les risques associés à mon innovation et comment est-ce que je propose de les gérer ?
- Les résultats attendus sont-ils crédibles, mesurables et réalisables avec les ressources prévues ?
Un projet se prête particulièrement bien à un appel ascendant si
- L’idée propose une solution très innovante à un problème existant qui n’a pas encore été formalisé ou testé ;
- L’idée identifie un problème spécifique qui s’inscrit dans le macro-domaine défini par l’appel ;
- Le projet a un fort potentiel de transformation et d’impact, avec la possibilité d’être étendu et reproduit à l’avenir.
- L’organisation proposante est en mesure de développer un projet qui comprend des stratégies pour faire face aux risques liés à l’innovation, par exemple avec des activités flexibles et des moments de vérification intermédiaires.
Dans l’approche ascendante, l’interdisciplinarité et l’intersectorialité sont souvent récompensées, c’est-à-dire la capacité d’un projet à travailler en synergie dans plusieurs domaines d’action pour résoudre un problème commun.
Exemples d’approches descendantes et ascendantes dans les programmes européens
Il n’est pas toujours facile d’identifier des « cas typiques » d’approches descendantes et ascendantes au sein des programmes européens : il s’agit plus souvent d’une « échelle de nuances ». En voici quelques exemples.
L’UE nouvelle génération, déclinée en Italie dans un plan national de relance et de résilience, prévoit 7 missions dans des domaines thématiques spécifiques, avec la définition d’objectifs, c’est-à-dire de résultats attendus des interventions, quantifiés à l’aide d’indicateurs mesurables et devant être atteints dans un délai donné. A cela s’ajoute un système d’
Dans des contextes comme Erasmus+ (dont le nouveau guide pour l’année 2026 a été récemment publié), on trouve une approche hybride : le cadre général est descendant, avec des objectifs, des priorités et des aspects transversaux clairement définis (nous en avons parlé ici). Certaines actions, en particulier l’action clé 1, comprennent toutefois des exemples d’approches ascendantes. C’est le cas de l’action « Activités de participation des jeunes » (KA154), qui place les jeunes au centre du processus décisionnel, dans le but de soutenir des projets visant à renforcer la participation des jeunes à la vie démocratique aux niveaux local, régional, national et européen. Dans le cadre de cet appel, les projets eux-mêmes naissent des idées, des initiatives et du dialogue des jeunes. Les animateurs de jeunesse et les organisations de jeunesse jouent le rôle de facilitateurs, mais le moteur du projet, ce sont les participants. Par conséquent, cette action est ouverte non seulement aux organisations, mais aussi aux groupes informels.
Un autre exemple d’approche hybride peut être trouvé dans Europe Créative, le programme phare de l’UE pour le financement de projets dans le secteur des arts et de la culture. Dans les appels à projets de coopération européenne, deux objectifs principaux liés à la conception et à la création artistique sont définis, un objectif de création et de circulation transnationale et un objectif d’innovation, mais une grande liberté est laissée quant au contenu et aux thèmes abordés par les projets. Ces appels sont également organisés à petite, moyenne et grande échelle, avec des exigences de participation croissantes (nombre de partenaires, nombre de pays européens impliqués, taille du budget), afin de permettre aux organisations plus petites et moins structurées de participer (vous pouvez en savoir plus sur la capacité organisationnelle et l’accès aux fonds européens ici et ici).
Il est possible de trouver des appels très fortement orientés vers l’approche ascendante dans les programmes de recherche et d’innovation tels que Horizon Europe. C’est le cas de l’EIC Pathfinder Open, un appel Horizon Europe du Conseil européen de l’innovation (EIC), le principal organe de l’UE chargé d’identifier, de développer et de mettre à l’échelle les technologies et les innovations. L’appel offre un financement à des équipes pluridisciplinaires pour des travaux de recherche ayant le potentiel de développer des technologies de rupture. Le plan de travail 2026 de l’EIC, qui contient des informations sur tous les appels financés et les échéances pour 2026, a été récemment publié et présenté publiquement lors de l’Infoday du 13 novembre 2025 (un enregistrement de l’événement est disponible ici ).
Nous avons examiné les approches descendantes et ascendantes, et nous avons vu comment elles sont toutes deux cruciales dans les appels à propositions européens. La clé du succès, cependant, est la même pour les deux approches : évaluer qu’il y a un véritable alignement entre notre idée et l’objectif de l’organisme de financement. C’est la seule véritable garantie pour éviter de rentrer chez soi… les mains vides.
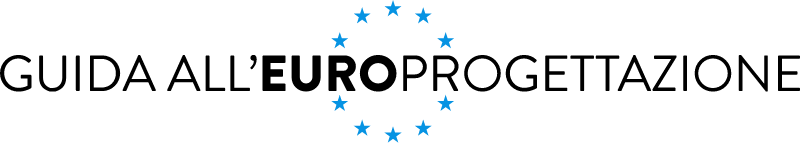



Scénographie ou clé de l’impact ? Les aspects transversaux dans les projets européens