Nous entamons une mini-série consacrée aux erreurs à éviter lors de l’élaboration d’un projet européen. Première question : votre organisation est-elle vraiment prête pour cette aventure ?
Capacité organisationnelle : commencer par qui nous sommes
Participer à un projet européen est une opportunité importante pour une organisation : en termes de ressources, de développement stratégique et d’activation de collaborations avec des partenaires internationaux. Mais la candidature à un appel, et par la suite la gestion d’un projet européen, est également une expérience complexe : elle exige un certain niveau de développement organisationnel et des processus internes que toutes les organisations ne sont pas en mesure de soutenir. En outre, la rédaction d’un projet implique une dépense importante de temps et de ressources internes, sans la certitude d’atteindre le résultat souhaité.
Au lieu de céder à l’angoisse de « participer à tout prix », il faut se demander si l’organisation est capable de faire face à tous les aspects de cette aventure :
- Disposons-nous de suffisamment de temps et de personnel pour rédiger le projet et le gérer ensuite ? Les implications de la préparation et de la gestion du projet ont-elles été partagées à la fois avec les personnes de l’organisation qui s’occupent des aspects techniques (pour aider à rédiger la proposition et les activités du projet) et avec celles qui s’occupent des aspects administratifs (pour collecter les documents, les données et les signatures pour la demande et pour l’activité de rapport ultérieure) ?
- Disposons-nous des compétences nécessaires, à la fois en termes de gestion de projet et dans le domaine du projet ? Ou, si les compétences doivent être développées, disposons-nous du soutien nécessaire?
- La participation à ce projet s’inscrit-elle à un niveau stratégique dans le cadre d’activités existantes ou est-elle totalement nouvelle ? Ou encore : pourrait-elle entrer en conflit avec certaines d’entre elles ?
- L’appel présente-t-il un degré de complexité adapté à notre organisation ? S’adresse-t-il à des organisations comme la nôtre ? Nous pouvons nous en rendre compte en analysant les listes de projets financés dans le cadre d’appels similaires.
Répondre honnêtement à ces questions permet de comprendre si le moment est bien choisi pour participer à un projet européen et, si ce n’est pas le cas, permet à l’organisation de commencer à développer les outils nécessaires pour pouvoir participer à un appel de fonds européen à l’avenir.
Les « nouveaux venus » dans les projets européens : avantages et définitions
Un aspect positif est que les programmes européens encouragent souvent la participation de nouvelles organisations.
Par exemple, dans le programme Erasmus+, certaines actions, telles que les partenariats à petite échelle, sont spécifiquement conçues pour encourager la participation de nouvelles organisations. Il s’agit de projets dotés d’une petite subvention (60 000 euros maximum), d’une durée plus courte et d’exigences administratives plus simples, dans le but d’atteindre des organisations ayant moins d’expérience d’Erasmus et moins de capacité organisationnelle, réduisant ainsi les obstacles à l’accès au programme. En outre, dans les évaluations d’autres actions Erasmus, telles que les partenariats de coopération, des points supplémentaires sont attribués si le partenariat inclut des organisations qui n’ont jamais participé au programme.
Dans le contexte des projets européens, il existe plusieurs définitions applicables aux « nouveaux arrivants », qui doivent être prises en compte. Vous trouverez ci-dessous quelques définitions d’application générale, dont certaines sont tirées du glossaire Erasmus+. Il est essentiel de vérifier au cas par cas, car il n’est pas exclu que, dans le cadre d’un programme de financement ou d’un appel spécifique, ces termes puissent acquérir des nuances différentes.
- Nouveau venu (nouvelle organisation participante): il s’agit de toute organisation participante qui n’a jamais reçu de soutien pour un type d’action spécifique soutenu par le programme, que ce soit en tant que coordinateur ou partenaire.
- Organisation moins expérimentée: toute organisation participante qui n’a pas reçu de soutien dans le cadre d’un programme particulier. Cette catégorie comprend également les « nouveaux arrivants » tels que définis ci-dessus.
- Premier candidat: tout organisme candidat à la fonction de coordinateur de projet (« candidat ») qui n’a jamais bénéficié d’un soutien en tant que coordinateur de projet dans le cadre de ce programme.
Ces définitions se réfèrent normalement à une période de sept ans (après une période de sept ans sans projet, on redevient un « nouveau venu ») et s’appliquent également aux éditions précédentes du même programme.
Nous sommes prêts, mais : les conditions de participation aux projets européens
Avant de participer à un projet européen, il est nécessaire de prendre en compte les exigences administratives et les critères d’éligibilité requis par le programme et l’appel. Bien qu’il existe un certain nombre de différences, qui sont explicitées dans les différents appels à propositions, les exigences portent généralement sur les points suivants :
- L‘expérience de l’organisation: dans de nombreux cas, il est spécifié que l’organisation doit avoir développé une expérience significative dans le domaine couvert par l’appel, dans un délai spécifique. Exemple : l’appel à propositions FEDER« Résidences pour les arts du spectacle » de la région Toscane n’autorise que les organisations publiques et privées ayant exercé des activités professionnelles dans le domaine des arts du spectacle pendant au moins deux ans au cours de la période triennale 2022-2024 à participer à l’appel.
- La capacité financière de l’organisation: dans de nombreux cas, il est exigé que l’organisation (en particulier l’organisation chef de file) dispose de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant la période pour laquelle la subvention est accordée, et pour participer avec les ressources nécessaires. Une liste de critères d’évaluation de la capacité financière est disponible au chapitre 4 d’un document séparé. Ces critères ne s’appliquent pas à certains types d’organisations (par exemple, les organisations internationales) et aux subventions inférieures à 60 000 euros. Dans ce dernier cas, seule une auto-certification est requise dans la demande.
- Le type d’organisation : les appels peuvent être plus ou moins ouverts à différents types d’organisations, ou être dédiés à des types spécifiques (organisations à but non lucratif, organismes publics, universités, organisations internationales, etc. Par exemple, dans certains programmes, la participation d’entreprises et d’organismes à but lucratif est autorisée, dans d’autres, elle ne l’est qu’en tant que partenaires ou prestataires de services externes au projet.
- Le siège légal de l’organisation: les programmes européens sont principalement destinés aux organisations des pays membres. Dans certains cas, à examiner programme par programme, la participation d’organisations de pays tiers est autorisée, tels que (selon le cas) les pays membres de l’AELE, l’Espace économique européen, la Suisse (qui participe par exemple à Horizon Europe, mais seulement à certaines actions Erasmus+), les pays candidats ou candidats potentiels, les pays du voisinage ou les pays non européens. Les exceptions sont bien sûr les programmes européens spécifiquement dédiés aux pays tiers : Global Europe (NDICI), le Programme d’aide humanitaire et l’Instrument d’aide à la préadhésion(IAP III).
Les projets à la croisée des chemins : choisir l’appel
Enfin, on est vraiment prêt à se lancer dans un projet européen lorsque l’appel est adapté à ses besoins, à tous points de vue. Voici quelques questions de contrôle finales, tirées en résumé de la section dédiée de notre manuel.
- Existe-t-il une correspondance entre nos objectifs, les objectifs du projet européen que nous envisageons et ceux de l’appel à propositions ? Notre idée, et notre activité en général, correspondent-elles aux priorités politiques fixées par le financeur ?
- Visons-nous la bonne dimension territoriale du projet européen ? Certaines idées ont du sens au niveau local, d’autres ont du sens ou fonctionnent mieux si elles sont développées en collaboration avec des partenaires européens. Le type de programme auquel il faut se référer change en conséquence.
- Ai-je vérifié que mes plans correspondent à ce qui est prévu en termes d’actions, de coûts éligibles et de limites de financement (et de cofinancement) ? Un projet européen ne finance pas tout, ou n’importe quoi, et nécessite normalement un cofinancement.
En conclusion
Pour ceux qui veulent vraiment aller dans la bonne direction, nous concluons notre examen par une série de questions plus sérieuses et quelque peu provocantes, que nous avons abordées dans l’un de nos précédents articles approfondis : les questions les plus fréquemment posées.
- Savons-nous ce que nous faisons ?
- Savons-nous pourquoi nous faisons cela ?
- Les bonnes personnes sont-elles impliquées ?
- Avons-nous réfléchi à qui fera quoi ?
- Allons-nous de l’avant à n’importe quel prix ou risque ?
- Est-il important que « nous » le fassions ou qu' »ils » le fassent ?
- Cela nous aidera-t-il à nous améliorer ?
- Y a-t-il une vie après le projet ?
Participer à un projet européen peut être une aventure passionnante, mais cela demande de la préparation et de l’auto-analyse. Il ne s’agit pas seulement de recevoir un financement, mais de s’engager dans un voyage qui peut conduire à redéfinir de nombreux aspects de l’organisation elle-même.
L’Europe accueille les « nouveaux arrivants » avec des outils et des chemins dédiés, mais il est essentiel de savoir clairement qui nous sommes et dans quelle direction nous voulons aller. Après tout, comme le disait Sénèque, « il n’y a pas de bon vent pour le marin qui ne sait pas où il va ».
Sommes-nous prêts à prendre le large avec conscience ?
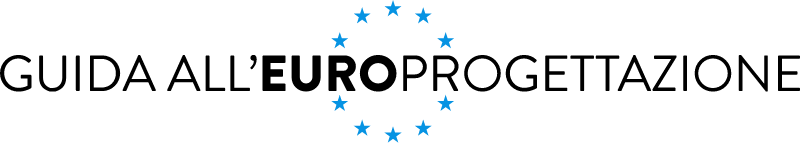



Comment devenir un euro-projecteur ?